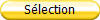La Banque
fait sauter l'État
Partie 1
L'État est en déficit, mais qui s'est jamais demandé d'où venait réellement ce déficit ? Le mammouth a bon dos, mais la vérité est ailleurs...
La retraite de l'État
Alors que l'on fait des gorges
chaudes des évènements de Seattle, que l'on
met en avant les troubles que le sommet de Nice à engendré, que l'on parle
plus de Porto Alegre que du réel contenu des débats à Davos, une cabale est
en marche pour nous convaincre que l'État, en l'occurrence l'État français, est
doté d'un nombre record de fonctionnaires (5,4 millions), soit un actif sur
quatre, et que la dépense publique est exagérée (54% du PIB), cette dernière
engendrant sous-productivité et parfois chômage. Tout en mettant en avant la
lutte croissante contre la mondialisation et ses méfaits, les médias se font
le porte-parole de ceux qui pensent que moins d'État est bon pour l'État. Mais
la montée en puissance du monde associatif, encouragée par un État qui a tout
à gagner de cette aide providentielle et bénévole, est symptomatique d'un
désengagement déjà avancé des institutions dans la société. Et ce désengagement
laisse le champ libre à des acteurs qui organisent les évènements à leur
avantage, comme on peut clairement le voir avec le problème des retraites pour
lequel on devra "privilégier la variable de la durée de cotisation pour
l'accès à la retraite à taux plein"*, une rhétorique soporifique qui
signifie ni plus ni moins, à terme, la fin de la retraite à 60 ans, mais dont
la formulation a l'avantage de ne pas faire ressortir les 300 000 manifestants
qui deux semaines plus tôt battaient le pavé pour les mêmes raisons.
Mais paradoxalement, ce sont ces futurs retraités que l'on a tendance a vouloir
garder dans le monde des actifs au sein du privé que l'on veut évacuer le plus
vite possible du côté du publique afin d'organiser en douceur une réforme
"nécessaire". A croire qu'il est plus productif de payer des
"vieux" cadres avec tous les émoluments dus à leur ancienneté que
des jeunes hyperactifs, bouffi d'ambition et donc de volonté, pour les quels la
menace du chômage tend à temporiser leurs éventuelles exigences salariales. A
croire que l'on aura un meilleur SERVICE public si l'on se sépare d'une
partie des effectifs qui assurent ce service. Qui n'a jamais fait la queue dans
un service administratif ? Qu'adviendra-t-il si l'on dégraisse le soi-disant
mammouth ? Tout cela traduit une stratégie du sauve qui peut qui en voulant
régler des problèmes d'ordre financier urgent va en créer autant, d'une
nature différente, dans les années qui suivront.
Les raisons de non-État
Je suis las d'entendre les comparaisons
que l'on peut faire entre la sphère
du privée et celle du publique, comme le fait Roger Fauroux dans l'ouvrage
"Notre État" : "(La fonction publique) n'a intégré aucune
conquête des systèmes modernes, la déconcentration des responsables, le
fonctionnement en réseaux, la transparence, l'émulation interne, la primauté
donnée à l'innovation, la rapidité de la transmission des informations, la
curiosité vis-à-vis de l'extérieur. Comment expliquer autrement que les
entreprises, avec un personnel somme toute ordinaire mais une excellente
gestion, parviennent à accomplir des performances extraordinaires, alors
qu'il faut, pour que des administrations fonctionnent passablement, que des
individualités exceptionnelles se dépensent sans compter à combattre
l'inertie de systèmes mal agencés et l'apathie d'un personnel mal employé ? "
C'est mettre de côté un peu rapidement tous les ratés des entreprises privées, de celle du canal de Panama où la banqueroute touchera prés de 800
000 souscripteurs, amenant le projet à être finalisé par des fonds publics (!)
américains pour leur plus grand bénéfice, ou encore celle des 66 satellites Iridium dont
le coût atteignait les 6 milliards de dollars et qui fut revendu 240 fois
moins à une nouvelle société, pour être finalement utilisé, une fois de
plus, par un organisme gouvernemental.
Je ne sais pas ce que Roger Fauroux entend par " déconcentration des
responsables ", mais si il voit un progrès dans le fait que ce soit les
actionnaires qui fassent la pluie et le beau temps sur la gestion d'une
entreprise, je ne vois pas en quoi cela peut être exemplaire, si ce n'est dans
le but de privilégier la richesse en oubliant les hommes qui la créent. Une
entreprise bénéficiaire ne l'est jamais assez pour l'actionnaire, comme nous
le montrent les malheureux employés de la branche biscuit de Danone. La plus-value
potentielle des plans de stock-options dans les grandes entreprises françaises
en 1999 a augmentée de 84,5 % en un an. Seulement 1 % des salariés
bénéficient de ces avantages, la majorité ne bénéficiant qu'à un petit
groupe de cadre dirigeant. C'est peut-être cela que R. Fauroux appelle "l'émulation
interne". Il faut prévenir les étudiants qu'avant Bac + 5, point de
salut, et les employés qu'ils n'ont qu'à suivre d'urgence les écoles de
formation interne si ils veulent profiter du gâteau. Dans cette comptabilité
là n'apparaissent pas les avantages matériels, comme la voiture de fonction,
qui contrairement à ceux de la fonction publique, paraissent naturels. Les
contrats à temps partiel en France, ou la flexibilité accrue en Angleterre,
cachent les vrais chiffres du chômage dans la sphère privée et accroissent la
paupérisation d'une majorité de la population qui ne peut formuler de projet
d'avenir à cause de la précarisation de sa situation.
Quand à la " transparence ", le PDG de Daewoo, Kim Woo-choong n'en été apparemment
pas un adepte assidu, puisque à l'heure ou j'écris ces lignes, il a
déserté son pays où il est soupçonné
d'avoir gonflé artificiellement de quelque 32,8 milliards de dollars les actifs
du conglomérat.
"La primauté donnée à l'innovation" n'est pas une exception
du privé, même si elle s'est ralentie ces dernières années. Mais ce
ralentissement n'est pas du à un dysfonctionnement de la machine publique, mais
à une volonté politique, de droite comme de gauche, du désengagement d'un État
qui laisse jouer ce rôle aux entreprises privées. Il ne s'agit pas de
générer du profit, à l'image du secteur privé, mais d'apporter un service.
On ne peut pas parler en fonction de "coût" et de
"productivité" d'une part parce que nous ne sommes pas dans une
logique marchande mais dans une logique de service, et que les relations
humaines dont découle ce service ne sont pas mesurables par des enquêtes des
instituts de sondage, ni évaluables, de par les multiples facteurs qu'elles font
intervenir, autant au niveau de l'employé que du client. Il serait fallacieux
de se servir des réformes entreprises dans la sphère privée pour arriver à
des buts qui sont par définitions différents pour la sphère collective.
L'erreur serait d'autant plus grossière qu'elle aurait pour conséquence
d'appliquer des méthodes de gestion qui sont loin d'être des modèles de
perfection, comme le montre les nombreuses entreprises qui fermeraient si elles
n'étaient pas rachetées par leur concurrent. Mais là est peut-être le but
ultime de ce vers quoi l'on veut faire aller l'État...
Mondialisation des règles financières
Malgré les soubresauts identitaires de certaines régions, il est clair que
la mondialisation fait son oeuvre, obligeant les pays à se réunir sous des
alliances économiques, alliances qui se transformeront à terme en des
alliances politiques. Souvenez-vous du tollé que les
Allemands ont soulevé lorsque ils ont parlé d'une "Europe
fédérale" par l'intermédiaire de Joschka Fischer. Mais cette idée a fait son chemin puisque à l'occasion
du sommet franco-britannique, qui s'est tenu le vendredi 9 février 2001 à
Cahors, Jacques Chirac évoque l'Europe en parlant d'une "fédération
d'États-nations". Cette dernière est une habile figure de style pour
parler d'une "Europe fédérale" qui ne veut pas dire son nom.
L'Europe nous impose une certaine santé économique et elle s'immisce jusque
dans la réglementation de la pêche à pied sur nos côtes ! Le problème que
nous rencontrons actuellement avec la fonction publique française, comme avec
celui des retraites, c'est avant tout une nécessité de mettre la France au
diapason de ses partenaires. Thierry Bert, chef du service de l'Inspection des
Finances, en est un exemple lorsqu'il déclare que "le rendement global
des services fiscaux français - rapport entre le coût des services et le total
des sommes encaissées - est 40% supérieur à ceux du Royaume-Uni, de l'Espagne
ou de l'Irlande, les systèmes suédois ou nord-américain coûtant deux fois
moins". Même le rapport de la Cour
des Comptes s'appui sur l'"exemple" européen pour étayer son
constat dans son rapport sur "La Fonction Publique De L'État" : "(...)
la fonction publique de l'État apparaît comme un ensemble complexe et rigide
qui n'évolue que lentement, alors même que plusieurs pays de l'Union européenne
ont réalisé ou amorcé, ces dernières années, des réformes profondes dans
le sens d'une souplesse et d'une décentralisation accrues."
Lorsque l'uniformisation des réglementations et des systèmes de
fonctionnements publiques aura été effectuée, il n'y aura plus d'obstacles à
la mise en place d'un gouvernement européen.
Du coup, l'euro est la monnaie d'un espace économique et non pas d'une puissance politique. Le dollar n'aurait pas pris une telle importance s'il ne s'appuyait sur une politique étrangère et une politique de défense forte. Selon moi, il faut résolument se tourner vers la constitution d'un véritable État fédéral. L'euro prépare en quelque sorte le terrain. »
Le Temps, Samedi 27 janvier 2001
La politique dans un sale État

La FED
La mondialisation de la politique sous cet
aspect est quelque chose de compréhensible et de défendable, mais le fait que
celle-ci intervienne après la mondialisation de l'économie me paraît plus
être de l'ordre d'un mouvement subi qu'une réaction face à l'emprise
croissante de la sphère financière sur notre vie quotidienne.
L'homme
politique définit les idées par lesquelles il gouvernera l'État, alors
qu'actuellement, le pouvoir économique applique ses théories, en l'occurrence,
le libéralisme, et l'État, quelque soit sa couleur politique, se laisse porter
par le courant. Le pouvoir politique en place, comme celui qui l'a précédé et
celui qui lui succédera, se contente de prendre des mesures d'ajustement qui
n'ont pour effet que de ralentir la décrépitude des avantages sociaux acquis
de haute lutte par nos ancêtres, ce qui s'explique par le fait que ces
avantages ont une fâcheuse tendance à augmenter les coûts de productivité.
On désigne l'État à la vindicte publique pour le réformer facilement. Les salariés du privé dénoncent les sois disant avantages des fonctionnaires, et trouvent plus juste de les supprimer que d'essayer de les atteindre par une lutte sociale dans leurs propres entreprises, comme l'ont fait leurs pères. On met à bas le dernier représentant d'un pacte social afin d'avoir toute l'amplitude nécessaire pour accentuer la libéralisation de la société. Le bonheur qui se devrait d'être le but vers lequel nous devrions tous tendre s'éloigne en partie à cause du rôle qui nous est donné dans la sphère privée. Ce rôle se limite à une instrumentalisation qui n'a pour seul objectif que la satisfaction de l'actionnaire. J'entends par le terme "actionnaire" le dirigeant dont les dividendes sont substantiels, et non pas l'actionnaire salarié en bas de l'échelle dont les quelques actions symboliques que l'entreprise lui a généreusement attribuées et dont les dividendes, une fois qu'il aura enfin le droit d'en bénéficier, ne couvriront même pas le montant de ses impôts...
Le vrai problème de la dette :
Mais le problème le plus important que rencontrent la plupart des États c'est la position de dépendance qu'ils ont par rapport à leur dette. En France, celle ci s'élevait à 5.200.000.000.000 Francs à fin 1999... Mais pire encore, ce sont les charges d'intérêt qui s'accumulent année après année, et qui représentent 80 % de la dette dans le cas français, et absorbent annuellement 15 % du budget, soit 240 milliards. Charles Collins, avocat, banquier et ancien candidat à la présidence américaine nous présente la situation des États-Unis face à leur banque centrale : « Actuellement, la FED a pris le plis de nous faire emprunter de l'argent avec intérêts pour payer des intérêts déjà accumulés. On ne peut donc pas sortir de la dette en nous y prenant comme on le fait maintenant. »
Les valeurs du tableau ci-contre sont simplement indicatives. Elles ont tout de même le mérite de représenter une tendance de chiffres. On constate aisément que malgré que les réserves de la France soient fluctuantes, elle restent comprises dans un zone moyenne, alors que la dette, ainsi que les charges de celle-ci, croissent se façon exponentielle. Il est aussi bon de souligner que le pourcentage de la dette sur le produit intérieur brut était en constante augmentation ces dernières années alors que le PIB n'a cessé d'augmenter. Il y a quelque chose d'illogique dans ce constat qui veut que plus on gagne, plus on doit !

Le fonctionnement des banques
« Je crois que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés qu'une armée debout... »
Finalement les orfèvres se rendirent compte qu'un très petit pourcentage de dépositaires ou de porteurs venaient les voir ou leur demandaient à retirer leur or. Ils commencèrent alors à frauder. Ils se mirent alors à prêter secrètement une partie de l'or qui leur avait été confié pour dépôt en sûreté, et à garder l'intérêt de ces prêts. Puis ils découvrirent qu'ils pouvaient imprimer davantage d'argent (c'est-à-dire de certificats de dépôt) qu'ils n'avaient d'or. Par la suite ils réalisèrent qu'ils pouvaient prêter cet argent supplémentaire et en tirer de l'intérêt, c'est ce que l'on appelle le prêt fractionnaire de réserve. Cette expression hermétique signifie que les orfèvres, les changeurs et maintenant les banquiers suivent une méthode qui consiste à prêter plus d'argent qu'ils n'en ont réellement en réserve. La FED appliquent ces opérations bancaires de fraction de réserve de la façon suivante. Un bon d'achat de 10 000 dollars de la FED résulte en un dépôt de 10 000 $ sur le compte du porteur. Sous l'impératif de réserve de 10 % (donc fractionnaire), la banque n'a d'obligation que de garder en réserve 1 000 $ ; elle peut donc prêter les 9 000 $ restant. L'emprunteur dépose généralement ces 9 000 $ soit à la même banque, soit à une autre banque qui doit, alors, garder 10 % en réserve (donc 900 $) mais peut prêter les 8 100 $ qui restent, et qui, à leur tour, seront déposés à une banque qui devra garder 10 % (donc 810 $) et pourra prêter les 7 290 $, etc...
« Si les gens de cette nation comprenaient notre système bancaire et monétaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. »
Au bout du compte, les 10 000 $ initiaux émis
par la FED sont entrés, par une
banque ou par une autre, dans le système bancaire et ils ont aboutis, par une vingtaine d'opérations successives, à un montant de 90 000 $ de nouveaux prêts, en plus des 10 000 $ pour les réserves. On doit
noter d'une part que la fixation du niveau des réserves, c'est-à-dire le
montant des liquidités disponibles, est le monopole des banques, et que d'autre
part de nombreuses exceptions font que certains dépôts n'exigent aucune
réserve, ce qui ne fait qu'augmenter le profit de la banque. Bien que seulement
une poignée des plus grandes banques crée de l'argent pour prêt, toutes les
banques en profitent directement ou indirectement, et encouragent donc le
processus.
Mais nos orfèvres n'en sont pas restés là. Lorsqu'ils favorisaient l'emprunt,
la monnaie en circulation augmentait. L'argent ne manquait pas, et les gens
faisaient davantage d'emprunts pour donner de l'expansion à leurs affaires.
Alors les orfèvres limitaient la mise à disposition de l'argent, rendant les
prêts plus difficiles à obtenir. Un certain nombre de personnes ne pouvaient
alors plus rembourser leurs prêts antérieurs, ni même obtenir de nouveaux
prêts pour payer les anciens. Ils déclaraient donc faillites et devaient
revendre leurs avoirs aux orfèvres, ou aux enchères pour une somme dérisoire.
Nous suivons les mêmes règles de nos jours. Thomas Jefferson déclarait : « Si
jamais les américains autorisaient les banques privées à
contrôler l'émission de leur argent, les banques et les sociétés qui
poussent autour d'elles priveraient les gens de tout bien, d'abord par
l'inflation, puis par la déflation, et leurs enfants se retrouveraient sans
toit sur le continent que leurs pères ont conquis. »

Les prêts fractionnaires de réserve institués par l'oligarchie bancaire permettent à ces dernières de gagner de l'argent en le tirant non pas des biens ou des services des hommes, mais en le créant. Et de cet argent créé à partir de prêts, viennent s'ajouter des intérêts dont l'emprunteur doit aussi s'acquitter. L'emprunteur se doit donc de rembourser non seulement de l'argent qui n'existe pas, mais aussi les intérêts sur cet argent virtuel.
La banque nationale prend ses ordres à l'international
Napoléon déclarait que quand un gouvernement dépend de banquiers pour son argent ce sont les banquiers qui ont le contrôle, et non les chefs du gouvernement : « La main qui donne est au-dessus de la main qui prend. L'argent n'a pas de patrie ; les financiers n'ont ni patriotisme ni décence, et le gain est leur seul objectif. »
Mais, depuis cette époque, les statuts ont changé et l'indépendance est de rigueur. La Banque de France est sensée
assurer « la continuité et la permanence de l'action de la politique monétaire,
dégagée des préoccupations de court terme, et de conforter ainsi sa crédibilité. »
Soit, mais lorsque l'on y regarde de plus prés, on s'aperçoit que la Banque de
France est intégrée au Système européen de banques centrales (SEBC) institué
par le traité de Maastricht. Et ce système est sous le joug d'un conglomérat
de banques nationales, qui agissent en fait en totale autonomie comme une institution
privée. Ce qui au départ se trouvait être une banque nationale indépendante
se trouve être dirigé par un ensemble de banques dont les intérêts ne coïncident
certainement pas avec ceux des états qui les abritent. J'en veux pour preuve
l'attitude de la Banque Centrale Européenne (BCE) en ce début d'année 2001,
qui maintient le statu quo sur son taux directeur malgré les pressions
internationales.
Le gouverneur gouverne... le gouvernement
Plutôt que d'une autorité monétaire centrale contrôlée par
les gouvernements, nous faisons face à une ploutocratie qui contrôle
l'économie du pays. Les banques centrales se servent des gouvernements pour
leur prêter un argent qu'ils n'ont pas la volonté ou le courage de demander au
peuple. Mais cet argent virtuel ne fait que gonfler la bulle financière grâce
aux méthodes évoquées ci-dessus. L'État se trouve être le débiteur d'un
argent qu'il ne possède pas puisqu'il ne correspond à aucun bien et qui est le
résultat d'un système usuraire. Et de plus l'État augmente l'argent en
circulation, cet argent a donc moins de valeur, et l'inflation atteint le peuple
qui en paie les frais par l'intermédiaire d'une perte de pouvoir d'achat. L'État
paie donc plusieurs fois le prix d'une confiance excessive dans la soi-disant
indépendance de son système bancaire.
Le numéro un de la publication Banque, Affaire, Finance du
mois d'avril 2000 nous confirme que : « Dans la plupart des pays du
monde
aujourd'hui, la Banque centrale dispose d'attributions très précises (...) et
régule donc l'évolution de la masse monétaire. Cela signifie qu'elle régule
indirectement le niveau des taux d'intérêts, des prix et du chômage (...). Le
rôle d'une banque centrale est donc crucial en matière de conduite de la
politique économique, car le niveau de la masse monétaire détermine
d'importants agrégats comme le taux d'inflation, le taux d'épargne, le taux
d'investissement, le taux de chômage, etc... » Là se situe le vrai mal international,
le vrai mal français, plus que dans n'importe quelle partie de la fonction
publique. Mais malgré toutes les difficultés promises quand à la future
réforme du secteur publique, elles ne sont rien comparé à celles que pourrait
rencontrer celui qui osera se mettre en travers de la route d'Alan Greenspan ou
de Wim Duisenberg, président de la BCE.
________________________
* extrait du texte élaboré à la suite de la réunion du 10 février 2001 entre les organisations syndicales et le MEDEF.
Le Nouvel Observateur, semaine du 18 janvier 2001, n°1889
Nexus, édition française, n° 1 et n° 2
Les Echos, lundi 29 au vendredi 2 février 2001, enquête sur la réforme de l'État français
Alternatives Economiques, n° 188, janvier 2001
Le Monde, n° 17434, dimanche 11 février 2001
Banques, Affaires, Finances, n°1, avril 2000
________________________
@conspiration.org
________________________
________________________
Si vous êtes en possession d'informations inédites
N'hésitez pas à me contacter
Moteur de recherche :
|
|||
| site search by freefind |